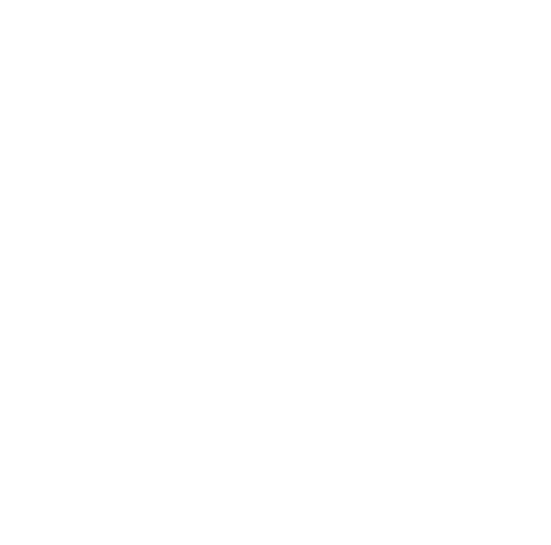
Chaque soir, face à la litanie des cas détectés, hospitalisés, graves, en réanimation ou décédés, nous étions dans un premier temps émus puis, en quelque sorte, anesthésiés par cette cascade de chiffres. Nous n’avions pas prévu qu’une autre réalité existait, et brutalement ces disparus ont commencé à être publiquement, quotidiennement et difficilement dénombrés : un bilan innommable, des situations impensables, des chiffres de charnier. Au milieu de cette révélation, il faut commencer à comprendre, à s’orienter dans le chaos de nos représentations, à saisir des fils et des mots pour le dire.
Ce qui se produit dans les EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) est bien une tragédie : par sa dimension, la nature de ses victimes, l’impuissance et les dysfonctionnements rencontrés auxquels s’opposent des personnels dévoués, peu reconnus et peu écoutés. La visibilité de cette tragédie ne nous permet plus de l’ignorer. Paradoxalement, cette tragédie qui s’impose à nous ne le fait que de manière parcellaire, comme un paysage, baigné de brouillard, qui ne se dévoile que par lambeaux. Pendant que les hôpitaux, leurs urgences et leurs services de réanimation, mobilisent médias et citoyens, ces institutions, faiblement symboliques, n’attirent ni attention, ni admiration, ni invitation à la reconnaissance quotidienne des « héros du soin quotidien ». Au moment d’une crise sanitaire majeure, cette dispersion structurelle et cet effacement symbolique semblent conjuguer dramatiquement leurs faiblesses. Mais un autre brouillard recouvre nos idées.
L’institution qui accueille devient lieu de strict enfermement. La protection rigoureuse devient maltraitance. Sans moyens, sans méthode, le foyer de vie se mue en foyer de contamination, la forteresse devient prison, piège. Tandis que cette dernière se fermait aux proches et à la famille, le virus, par brèches, continuait à l’infiltrer. Faute d’avoir pensé ces barrières à l’entrée par impréparation, manque de moyens ou pusillanimités administratives, l’inacceptable s’est produit, plongeant des personnels dans l’impuissance et la détresse.
À ce tableau si sombre, une idée s’oppose : ces morts seraient-elles si choquantes que cela ? L’âge très avancé des résidents des EHPAD, leur extrême fragilité, n’atténuent-ils pas le scandale de leur mort ? Après tout, n’était-ce pas une fatalité ? D’autant plus que pour ces résidents qui ont peu d’années devant eux, le temps de leur vie est seulement légèrement raccourci. Après tout, ce n’est pas si grave. En outre, en période de pénurie de lits d’hospitalisation, il vaut mieux choisir celui qui a le plus de chances de survivre. Enfin, après tout, on sait que l’hospitalisation risquerait de leur être douloureuse et souvent inutile, la réanimation sûrement fatale. Tous ces « après tout » font vaciller nos valeurs éthiques.
En effet, une des valeurs essentielles auxquelles s’adosse l’action médicale est : « D’abord ne pas nuire » (primum non nocere). Ce n’est pas un précepte hippocratique, cela en est même une inversion, puisque le « d’abord » portait sur l’injonction de rechercher en premier le bénéfice du malade, au risque bien calculé de lui nuire. Si ce précepte, tronqué et inversé, a pu justifier toutes les précautions médicales nécessaires, il rend également possibles toutes les abstentions, les refus de soin, l’absence de soulagement par antalgiques… jusqu’aux pires manquements. Cette perversion d’un principe mal compris pourrait-elle être à la source des refus d’admission des personnes les plus âgées ?
À la suite du « après tout », la question du « à quoi bon ? » mérite d’être posée à nouveau. Les fondateurs de la médecine hippocratique l’ont posée sans ambages : « Faut-il soigner les cas désespérés ? » Devant de très graves blessures, ils se trouvaient dans l’impasse d’une décision sans issue : infliger des soins extrêmes, placer le malade plus près de la mort que de la vie, et le faire souffrir inutilement, ou ne pas le soigner et risquer de passer pour lâches ou incompétents. Leur attitude d’abstention fut sévèrement critiquée dès leur époque. Elle a cours encore aujourd’hui, car il n’est pas sûr qu’ils aient eu tort, avec leurs moyens. Comme si, aujourd’hui, le refus d’admettre les personnes très âgées était justifié, non par les faits, mais par le regard porté sur eux, fixé par l’étiquette apposée au dossier, « non réanimatoire », « dément »…
Face à un choix sans issue, un même impératif surgit : faire du moins ce que l’on peut faire d’utile, en toute circonstance, comme soulager la douleur, choisir des positions qui ne nuiront pas dans l’avenir, prévenir les escarres… et beaucoup plus généralement, adoucir la solitude, apaiser les angoisses, parler et écouter. Pour cela, il faut des personnes qui auraient pour rôle d’assurer ces soins-là, ou même d’être seulement présentes.
Comment repenser aujourd’hui le champ de l’infection, de la contagion, à la lumière des épidémies du passé ? Quels modèles nous évoquent-ils ?
Puisque le virus circule entre les personnes, qu’il les touche à l’aveuglette ou qu’il aime en quelque sorte les corps nouveaux, les gestes barrières l’arrêteront, ou du moins le détourneront. « Il ne passera pas par moi » disait un slogan du temps du sida. Cette protection est à double sens. C’est la morale de la vaccination, celle des mesures que l’on cherche aujourd’hui en tâtonnant, à l’image de celles qui ont été déjà mises en œuvre par le passé. Lors des maladies contagieuses, comme la tuberculose, on décidait d’éloigner les malades et de les soigner dans les sanatoriums à la fois pour se prémunir d’une transmission de la maladie et pour optimiser leurs chances de guérison. Le soin était à double sens : aider le malade par de meilleures conditions de vie, protéger les siens par l’éloignement.
Pour une maladie vivement contagieuse, on doit séparer très vite les malades des autres, non pour soigner mais pour sauver. Quand les bergers séparaient une brebis des autres à la première suspicion de la maladie, ils savaient que le salut du troupeau dépendait de cette rapidité. C’était leur tâche et leur responsabilité. On nous a dit : « Séparez les résidents des EHPAD les uns des autres, éloignez-les indistinctement des leurs. Coupez les liens, confinez-les dans des lieux où ils ne verront plus la lumière, privés de visites, de leurs soignants habituels, de ceux qui les aident à soutenir l’ennui. On viendra les nourrir juste pour les empêcher de mourir. » Cela s’est passé ainsi parfois, parfois différemment, et souvent beaucoup plus mal. Les personnes âgées se sont mises à ne plus désirer vivre. Et beaucoup sont mortes. Avons-nous compris ce que cette réponse à la contagion nous a fait perdre ? Avons-nous perdu le savoir des bergers ?
Le temps est proche où le brouillard se lèvera. Nous comprendrons peut-être sans colère que presque la moitié des morts ont été invisibles. Nous pourrons faire l’histoire d’une nouvelle épidémie, et forger des outils éthiques, prêts pour la prochaine.
Quels outils ? Les philosophes contemporains ont revu les grandes notions comme celles de justice, de reconnaissance, de responsabilité et bien d’autres, toutes porteuses de sens, auxquelles s’ajoutent des valeurs liées à l’inégalité croissante des conditions et le respect de notre environnement. Avant d’en forger de nouvelles, nous pourrions commencer par revenir à la première Déclaration des droits de l’homme, celle que nous connaissons tous. On y ajouterait simplement, mais en lettres inaltérables, que si les êtres humains « naissent et demeurent libres et égaux en droits », ils le sont « tout le temps de leur vie, jusqu’à la vieillesse et à la mort ». Nous aurions ainsi les droits et les devoirs d’en faire l’affaire de tous, et de ne plus avoir à regretter amèrement les failles de notre vigilance.
Conseillère de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France.