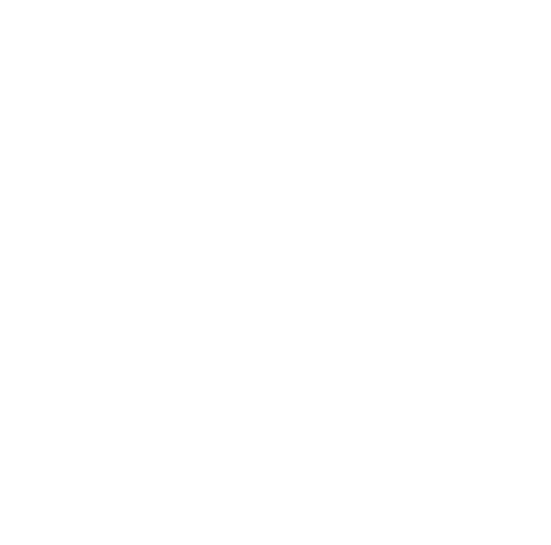
« On a beaucoup agi ces derniers siècles, on n’a peut-être pas assez pensé », remarque Nietzsche. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, soutient, dans ses Rêveries du promeneur solitaire, que l’isolement rapproche les hommes, bien plus que l’agitation étourdie de leurs interactions intéressées qui, elles, les blessent. N’est-ce pas là la morale de Jonathan Livingston Seagull, la merveilleuse nouvelle de Richard Bach, cet écrivain ancien pilote de l’armée de l’air américaine, qui narre l’envol de Jonathan, ce « goéland qui sommeille en chacun de nous », loin au-delà des coups de bec mesquins de ses congénères attroupés, jusque vers Chiang, l’Ancien, le sage, qui lui apprend à voler par la pensée, et à aimer ses semblables.
Le confinement invite, par la séparation, à l’alliance. Le mot hébreu Berith ne signifie-t-il pas à la fois l’une et l’autre ? « L’homme n’est qu’un nœud de relations. Les relations comptent seules pour l’homme. » En regard de cette fameuse formule d’Antoine de Saint-Exupéry, la distance rend à chacun, chez lui, comme pour cet autre aviateur dans son habitacle, la saveur propre aux vraies rencontres, remémorées, ou relancées librement, par quelque artifice électronique. On sait que Jean-Paul Sartre osait affirmer : « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’Occupation », puisque l’option entre le Bien et le Mal y était en principe limpide. Peut-être alors peut-on dire aujourd’hui, puisque que nous sommes comme « désinfectés » de l’inauthenticité grégaire des foules, que jamais nous n’avons été aussi ensemble que sous la contrainte de cet isolement forcé.
Car n’est-ce pas en réalité la foule qui nous sépare, effaçant la singularité de nos individualités, et nous entraînant dans le flux de son anonymat « acéphale », selon le mot de Georges Bataille ? « La foule, c’est le mal », disait Søren Kierkegaard, anticipant les développements si éclairants de Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules de 1895, qui montre la continuité entre millénarisme médiéval et engouements populaires modernes : « Peu aptes au raisonnement, les foules sont au contraire très aptes à l’action […] Les foules ne connaissent que les sentiments simples et extrêmes […] Il en est toujours ainsi des croyances déterminées par voie de suggestions au lieu d’avoir été engendrées par voie de raisonnement […] N’ayant aucun doute sur ce qui est vérité ou erreur, et ayant d’autre part la notion claire de sa force, la foule est aussi arbitraire qu’intolérante. L’individu peut supporter la contradiction et la discussion, la foule ne les supporte jamais. »
Sigmund Freud surtout, dans son fameux essai Psychologie des masses et analyse du moi, de 1921, a poursuivi cette analyse des errements de la psychologie collective, dont l’identification au chef charismatique, que lui inspiraient les mouvements de masse menaçants de son temps, et dont la vague montante allait plus tard ravager le monde par la guerre, et mener au génocide de son peuple et au massacre de sa propre famille.
Or le mal aujourd’hui a repris, pour un temps d’une durée peu prévisible, sa forme extérieure originelle d’hostilité naturelle Mais celle-ci a été néanmoins exacerbée par la folie des hommes : de leur avidité de déforestation abusive, et leur voracité les livrant à une promiscuité indécente avec la vie sauvage, à la rétention mortifère d’informations vitales, due au mépris cynique de pouvoirs tyranniques pour la liberté d’expression des sociétés ouvertes. Voilà donc en retour le Bien soudainement et cruellement clarifié : il se révèle résider radicalement dans l’être-ensemble démocrate de citoyens égaux, attentifs les uns aux autres, soucieux d’être éclairés et informés. Le grand historien Pierre Chaunu rappelle à ce propos que la démocratie moderne, bien avant l’isoloir, était déjà comme en germe dans la dévotion dite moderne, la « dévotio moderna », de moines des Pays-Bas du XIVe siècle, merveilleusement peints par Hans Memling, dont la réforme spirituelle consiste à s’isoler pour prier, et cultiver leur intériorité, avant de se dévouer d’autant mieux pour autrui. Le mot « moderne » vient en effet du mot latin modus, qui signifie « mesure ». Et sa propre mesure, on ne la prend qu’à part soi. Montaigne, plus tard, dans son château, préfèrera ainsi écouter l’office religieux seul dans sa « librairie », où il se recueille, par une fosse ouverte du plancher.
C’est qu’il faut commencer d’être soi pour aller vers les autres, même si c’est par les autres et avec eux, que l’on advient finalement à soi-même. Le récit biblique l’indique en Exode, 2,11 : « Et il y a eu en ces jours-là [ ] et que Moïse avait grandi [ ] et il est sorti vers ses frères [ ] et il a vu [ ]leurs fardeaux » (Les Noms, traduction de H. Meschonnic, Paris, Desclée de Brouwer, 2003).
Aller vers ses frères suppose d’avoir « grandi », comme le rabbin Léon Ashkenazi le soulignait. La grandeur, c’est la bienveillance, fruit d’une patiente maturation, par laquelle on se rassemble avec soi pour s’épancher vers les autres. Puisse cette épreuve aviver le goût de la fraternité, de la lucidité, et de la mesure, ces seuls vrais boucliers de notre commune vulnérabilité.
Professeur de philosophie morale et politique à l’Espace éthique de la région Île-de-France.