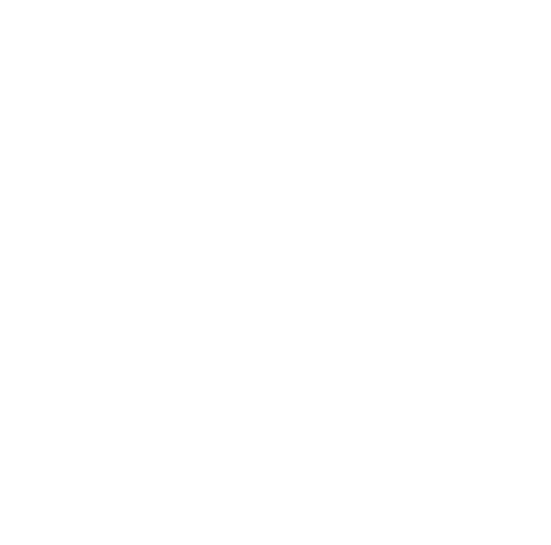
Il y aura bientôt un an que François est mort, la semaine juste après Pâques 2020. Cette terrible semaine.
Il a été emporté par l’un des rares cancers qu’on ne sait pas encore soigner. Rien à voir donc avec le Coronavirus qui venait de déferler en tsunami sur la planète. Et pourtant…
Du jour au lendemain, plus de visites des proches, plus de bénévoles, plus d’accompagnement digne de ce nom, en fait, pour pallier l’échec médical annoncé. François avait quarante-deux ans et savait qu’il laisserait derrière lui sa jeune femme de trente-cinq ans, seule pour élever trois petits garçons de huit, six et trois ans. Comment peut-on priver ainsi de soutien un jeune père de famille, que nous savions tourmenté à l’extrême devant ce qu’il considérait à son corps défendant comme un abandon de sa part ?
Mais ce n’est pas tout.
François est mort aux petites heures de la nuit, dans la plus inhumaine des solitudes. Lorsque sa veuve a été prévenue, son corps nu avait déjà été emporté à la morgue dans une housse de plastique, comme on le fait pour une bête que le vétérinaire vient de piquer. Le « protocole » sanitaire avait été appliqué à la règle… qui ne s’imposait pas pour lui, exempt de l’infection.
Il n’a pas non plus été possible de le revoir en chambre mortuaire avant la fermeture du cercueil. Et ses fils n’ont donc pu que jeter à même la fosse les menus objets et les dessins, déchirants témoignages de leur amour d’enfants, qu’ils avaient apportés pour leur papa. Au cimetière c’était à hurler : mais seules vingt personnes ont été admises à la cérémonie d’adieu, où on était prié d’être capable de se tenir debout tout seul, car il fallait respecter la « distanciation sociale », quelle horrible expression d’une réalité qui l’était tout autant.
Un an après, que reste-t-il de tout cela ?
Un deuil profond, lancinant, interminable, comme une plongée aux enfers dont on ne peut se défendre. Une douleur inextinguible. Un doute affreux aussi : sommes-nous bien sûrs que c’est bien lui que nous avons enterré dans le caveau de famille ? Une culpabilité tenace : celle née du sentiment de ne pas avoir rendu hommage à son corps comme il convient de le faire, en le faisant revêtir de vêtements soigneusement choisis à l’image de l’homme, du père qu’il était. Un vide impossible à combler, celui des rites anthropologiques à accomplir et qui ne l’ont pas été, celui des rites religieux bâclés qui ne consolaient plus personne.
Apparaît aussi en filigrane des échanges familiaux depuis ce moment douloureux la culpabilité de ne pas avoir pu, comme Antigone face à Créon, réaffirmer que les morts n’appartiennent plus à la cité et à ses lois, mais à leurs familles et à leurs rituels. Pour forcer le respect puisqu’il n’était plus naturellement dû. Le prix à payer de cette transgression des lois humaines, aux plans familial et amical, est très élevé. Les traces laissées sont profondes, la cicatrisation sera longue.
Mes pensées, et ma révolte intacte, vont vers les familles des 685 000 personnes décédées entre avril et décembre 2020 [1], et au-delà, qui ont dû subir plus ou moins à l’identique ce que les proches de François ont enduré, et doivent en ce moment même éprouver le même ressenti ; la dette morale de la société à leur égard dépasse largement à mes yeux toute espèce de dette sociale contractée au cours de cette terrible année.
Nous avons sacrifié l’humanité de l’homme au coût de la santé, oubliant ce que Emmanuel Kant [2] affirmait avec force : que les choses ont un prix, et les hommes une dignité. Cette dignité dans la mort, que nous n’avons pas su préserver…
[1] Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394?idbank=000436394
[2] Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785.