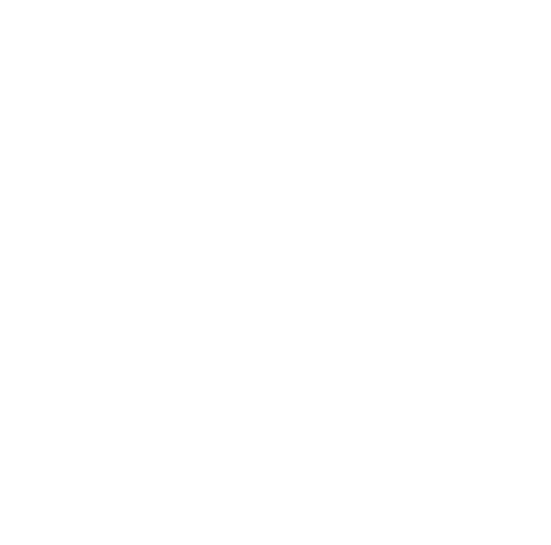
Virus, unique objet… Voilà plus d’un mois que toute la communication gouvernementale, toute l’information diffusée par les médias, tout le débat public, dans leur absolue intégralité, ont trait au coronavirus. Contrepoint obstiné au confinement du pays, le récit récurrent de la menace virale, décliné à longueur d’écran, de micro, de colonne, installe la cité dans un paysage de guerre biologique et requalifie l’espace et le temps de la vie commune comme un champ de bataille contre la mort. Face à ce déferlement monoïdéique, afin de contenir un syndrome obsidional moralement et politiquement dévastateur, on aurait besoin de gestes-barrières. Il y va de la préservation de nos défenses critiques, donc de notre santé démocratique, elle aussi en péril.
Que soit d’abord prévenu tout malentendu : inviter la République à se déprendre de sa fascination collective pour l’œuvre morbide de l’épidémie ne signifie ni déprécier ceux qui aujourd’hui sont en première ligne du combat sanitaire, ni relativiser la gravité de ses enjeux. Les hommes et femmes de l’art sont là où la nation les attend, voire bien au-delà de ses attentes et de leurs propres forces, on ne leur en saura jamais assez gré. Mais dans leur longue histoire, ils ont toujours rempli leur mission d’accueil et de soin sans avoir cure de se mettre en vedette, encore moins d’être applaudis. La polarisation exclusive de l’information et du débat sur l’épidémie n’est pas le fait du corps soignant. Conviés à se succéder sans discontinuer sur les plateaux médias, ses représentants ont suffisamment à faire ailleurs pour éprouver le souci d’être leur propre chœur antique. En revanche, si les professionnels de santé sont aussi largement sollicités pour un exercice de parole publique dont ils ne sont ni coutumiers, ni demandeurs, c’est parce que ceux à qui incombe cet exercice, les responsables politiques en l’occurrence, font défaut non seulement pour expliquer, mais plus gravement, pour gouverner. L’inflation de la glose médicale révèle ce défaut d’un gouvernement de la crise, la vacuité d’un verbe et la vacance d’un projet. Sous le “manteau de paroles”, comme dit le poète, d’un commentaire ad nauseam confié aux experts, ce sont les silences de l’action publique qui résonnent. En somme, loin de traduire l’importance du défi sanitaire à relever, la viromanie actuelle paraît être l’indice d’un grand désarroi du pouvoir : d’une part dans sa recherche si confuse d’une politique de lutte contre le virus, d’autre part dans sa détermination si hésitante à rester un pouvoir politique, capable d’opposer à la crise la constance d’une autorité souveraine en charge du destin d’un peuple de citoyens, sans se dissoudre en un biopouvoir gestionnaire de la santé d’une population.
La réponse politique donnée au fléau viral a mis des semaines à trouver une cohérence, toute schématique et bien fragile au demeurant puisque n’ont pu être dissipées, après quatre allocutions du chef de l’État et deux conférences de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé, de nombreuses incertitudes sur la pénurie prolongée de matériel médical et paramédical, sur le flou de la méthode adoptée pour une contention efficace de l’épidémie à l’issue du confinement, non plus que sur les caps fixés pour le redressement de la France, sinon pour sa réanimation. Quelle déception, par exemple, de découvrir que la culture, d’un poids économique équivalent à celui de l’industrie agro-alimentaire, d’un enjeu symbolique constitutif de notre personnalité commune et d’un sens pourtant jugé “essentiel” par le président philosophe, ne faisait pas partie des grands axes de continuité de la vie de la nation !
Plus en amont, la défection du politique s’est illustrée par l’incurie des gouvernements successifs en matière de préparation technique et logistique à une situation de pandémie, induisant les manques que l’on sait et une précarité des ressources palliée par un révoltant recours au système D. Cette défection du politique s’est également manifestée par une fâcheuse incohérence décisionnelle, frisant parfois le grotesque mais pas toujours dénuée de rouerie, dans les options pour le moins versatiles défendues par les responsables publics quant à l’usage de masques et de tests… de toute façon indisponibles, ou quant à la prescription d’un traitement controversé. En outre, et à une échelle plus générale, c’est le choix d’une mise en panne durable, massive et peu modulée de la société française qui suscite la perplexité, non tant par rejet du principe même du confinement, dont le bénéfice prophylactique semble établi, que par crainte des probables effets mortifères de cette mise en coma artificiel de tout un pays, condamné sur ordonnance à une régression sociale, économique et culturelle sans précédent. Est-il légitime de privilégier de façon exclusive une problématique médicale de la crise, fût-ce une crise sanitaire, quand celle-ci bouleverse le mode de vie de toute une société ? N’assiste-t-on pas ici à un effacement de la responsabilité politique, à une fuite en avant vers un biopouvoir accordant à la santé du troupeau la priorité sur le contrat social ? Les carences observées en termes de ressources et de doctrine ne sont pas d’abord sanitaires, mais politiques : celles d’une politique de la santé et d’un pouvoir qui, confronté à sa propre impéritie et pris de panique, a dû se résoudre à remettre les clefs de la décision aux médecins.
Tel a été le parti adopté par le président de la République. En se vantant au début du mois de mars d’avoir effacé de son agenda tout ce qui ne concernait pas le coronavirus, il s’est démis de son pouvoir en faveur des professionnels de santé. C’est ce qui advient à chaque fois que le politique renonce à gouverner et s’efface devant une corporation experte, médicale, religieuse, militaire, financière ou autre, qui se prévaut de son rôle salvateur pour voir midi à sa porte, ignorer le reste de la réalité et s’abstraire de l’épaisseur humaine de la cité, pourvu que ses propres objectifs, si louables soient-ils, soient atteints.
Juste retour, bien sûr, des choses d’ici-bas : les Français ont élu Emmanuel Macron parce qu’il n’était pas un politicien, ils ont clamé sur tous les tons leur méfiance, voire leur mépris envers la classe politique, ils ne sont donc pas surpris de découvrir qu’il n’y a pas de réponse politique à la crise sanitaire, que la plupart des élus, encore il y a peu en campagne, sont muets, et que faute de projet capable de mobiliser les forces vives de la République, celle-ci se trouvera finalement mieux d’être gouvernée par des médecins. Or, quoique légitimes dans l’exercice de leur art, ceux-ci n’ont nulle compétence à conduire les destinées collectives… pas plus que n’en auraient des prêtres, des généraux, des banquiers ou des informaticiens.
L’émergence d’une dimension biopolitique de la cité moderne, et notamment démocratique, est un processus séculaire, irréversible et pas intrinsèquement pervers. Les responsables politiques sont désormais comptables de la santé des sujets membres du pacte social, mission plus complexe et plus humaine qu’elle ne l’a jamais été : pour n’en citer qu’un récent exemple, Jacques Chirac, un temps persiflé pour avoir fait du cancer, des accidents de la route ou du tabagisme des fronts de politique générale, a fait grandir le pouvoir présidentiel. Mais la dimension biopolitique doit rester une dimension, et ne pas supplanter toutes les autres pour s’ériger en biopouvoir. Ce dernier est une impasse démocratique, même lorsqu’il prend les commandes pour sauver des vies, car il ne sait gouverner que des populations, et non des citoyens.
Philosophe